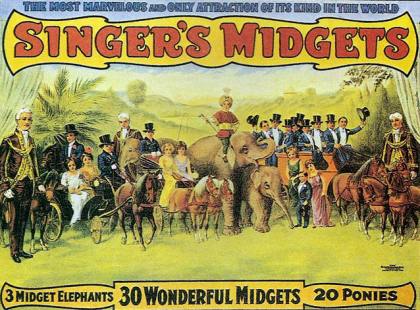Crash-test
Publié le
Éros et Thanatos asservis par Mammon dans le fracas feutré des tôles froissées et des corps esclaves que rien ne sauve.
Publié le 20 août 2015 chez Actes Sud, le nouveau roman de Claro (son treizième) poursuit la pénétrante exploration des composantes mythographiques qui informent notre présent et notre futur, comme il le fait avec toujours davantage de puissance, depuis « Livre XIX » (1997), « Bunker anatomie » (2004), « CosmoZ » (2010) et « Tous les diamants du ciel » (2012), pour ne citer que quatre cairns majeurs de cette entreprise, ô combien passionnante, et potentiellement décisive.
Convoquant à la barre, dans un dessein subtil et d’abord bien mystérieux, le crash automobile industriellement simulé, Claro met naturellement en piste J.G. Ballard et son « Crash » de 1973 (et dans une moindre mesure David Cronenberg pour le film qui en est issu en 1996), mais c’est pour habilement et rapidement s’en démarquer : le propos ici n’est pas, ou plutôt ne se limite absolument pas, à la mise en scène des fantasmes contournés d’une libido de l’âge du béton précontraint triomphant, et de l’urbanisme automatisé qui l’accompagna, faisant succéder dans la geste du « Visionnaire de Shepperton » les apocalypses relatives et nettement mortifères aux apocalypses absolues et presque poétiques des premiers temps de son œuvre.
AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’ACCIDENT. Il le sait, l’a toujours su, et ce depuis sa naissance dans les entrailles d’une clinique d’abattage où, à toute heure du jour et de la nuit, sous des traînées de néons, les ventres béaient et se contractaient au rythme du sang pulsé, les matrices saturant l’air d’ondes et de cris qu’aussitôt recrachés les avortons aspiraient goulûment, leurs yeux d’agoutis brûlés par l’incandescence des lampes, avant d’être secoués, rincés, palpés, intubés pour certains, cajolés pour d’autres, carambolés de salle en salle dans l’urgence de leur salvation ou bien chrysalidés dans du linge empestant le dakin, la scène se répétant inexorablement tandis qu’au-dehors, là où vivre était devenu coutume et châtiment, hurlaient les sirènes, celles des ambulances piaffant au seuil des urgences, et celles de la ville célébrant une fois par mois la possibilité du chaos.
(…)
IL TRAVAILLE DEPUIS AOÛT 72 pour un fabricant d’automobiles. Il teste la résistance des habitacles, au gré des heurts, à l’aide de cadavres. Il dirige le département crash-test et touche un smic et demi.
Les crash-tests, c’est l’enfer à la merci du millimètre.
Le temps ? l’espace ? les échappées belles ? l’ivresse de la vitesse ?
Oublie. Tes chances de survie sont désormais très très faibles, car tu es né à même l’accident, et dans l’accident tu disparaîtras, tel un Spartiate à l’heure thermopyles.
Son travail : recréer artificiellement les conditions du désastre. Emboutir, broyer, déformer, puis détacher, détailler, analyser et, autant que possible : remédier. Mesurer tout ce qui rompt, gicle, s’embosse, cède. Recommencer, des dizaines, des centaines de fois, en modifiant systématiquement les paramètres du choc. De la chorégraphie, ou presque. Éprouver les variables. Contrarier les élans. Bref.
Le crash-test, c’est :
• l’étude du comportement de l’habitacle et de ses spectres.
Autrement dit :
• l’étude du monde et de ses particules.
Une physique de l’enfermement, quand le corps tressaute et absorbe la vitesse au cours d’un bing bang de métal, d’isorel et de chair.
Il convient d’ausculter la destruction et ses lois, pour mieux les saisir, les dompter. L’accident est un défi, la mort un malus. Les plaies diront qui a eu tort.
C’est en intégrant patiemment à la cuisine des corps morts à torturer pour la sécurité et l’assurance des corps (encore un peu) vivants deux autres dimensions que l’on pourrait d’abord croire érotiques que Claro développe ici l’alchimie qui fait de lui l’un des plus robustes mythographes contemporains, allant creuser loin sous les images à la surface vaguement séduisante ou scandaleuse desquelles s’arrêtent tant d’auteurs. L’adolescent utilisant le papier glacé de bandes dessinées pornographiques pour accéder à la masturbation – mais n’est-ce pas avant tout pour fuir la cellule familiale désespérément mortifère qui semble l’environner en ces trente glorieuses ? – comme la strip-teaseuse dardant depuis son piédestal offert un regard acéré tentant tout aussi désespérément de neutraliser l’accablant désir de domination qui lui fait face : deux vecteurs, deux narrateurs, deux trajectoires que résumerait et télescoperait dérisoirement et tragiquement le personnage de Linda Lovelace, l’héroïne fameuse du film « Gorge profonde » (1972), exploitée par son maquereau de mari et broyée in fine par une industrie avant de l’être par un accident automobile, précisément, un soir de 2002.
Vous aviez des projets ? Vous rêviez d’instants qui soient comme des privilèges, d’omoplates que laque et dore la claque du soleil ?
Tirez un trait ————————— et sur ce trait n’essayez même pas de marcher. Le monde envahit votre viande, débusque les os, les libère. Sud Radio vous annonce un remaniement, ça tombe bien. Vous êtes remanié. Adieu le repos et adieu la lecture du journal au café, la serveuse aux talons qui cliquent ne viendra plus, le café dans la tasse jamais ne tiédira, il n’y aura pas de jour de marché, pas de baiser sous les lampions, vous avez choisi la route, or la mort fait de l’auto-stop, et son pouce est un pieu sur lequel s’empaler. N’espérez pas survivre, prenez le temps de mourir, pensez à tout et à rien, laissez flétrir vos devenirs dans ce tambour de machine à laver qu’est devenue votre Peugeot ou votre Simca, regardez ! le ciel se dérobe ! les champs s’interposent ! et voilà qu’un arbre, dans sa générosité de bois, désigne déjà du bout de sa branche le nid de votre crâne. Comment rester immobile quand on est en feu ?
À travers un hommage, renouvelé tout au long du roman, à Vanessa Veselka et à son premier roman « Zazen », que Claro a édité en français, et bien entendu à J.G. Ballard, qui tôt discerna le potentiel des tôles froissées, nous assistons ainsi, légèrement incrédules initialement, à une aussi formidable que discrète actualisation, à un travail subtil, fureteur et décisif, qui décèle la manière dont Éros et Thanatos, une fois décryptés tout au long des années 1970-1980 par Marcuse, Deleuze, Guattari et Foucault, se sont révélés in fine quelque peu inoffensifs, avant que le banc-test des années 1990 ne leur adjoigne avec Mammon (qui chez les Grecs est d’ailleurs éclaté entre Hermès et Hadès, semble-t-il), triomphateur, muni d’une virulente cohorte d’adorateurs, et autrement conquérant, le troisième larron leur redonnant tout leur potentiel de destruction et de domination, redonnant un sens violemment neuf à l’idée de domination masculine sans doute trop vite enterrée alors.
Elle était autre chose, n’en doutons pas, et sa légende la précédait afin qu’elle n’en soit que l’insolente confirmation. Ceux qui l’admiraient de près, cravate dénouée, poches retournées, se sentaient plus seuls qu’un sexe d’homme dans la poigne d’une femme qui vous sent favorable à l’idée de viol et cache une lame de rasoir entre ses dents. Ceux qui l’avaient aimée de leurs phalanges crispées, de leurs gros doigts bourgeois, ceux qui avaient mouillé du gland et des yeux quand, aux accents du saxo qui pourtant n’avaient rien de salace, elle s’avançait du pas de celle qui piétine, à chaque baiser-semelle, la main du mâle, ceux-là sentaient bien qu’elle ne les aimait pas, pas comme ils l’auraient voulu. Et ils comprenaient à l’instant t de sa disparition, quand les ronds de couleur cessaient de batifoler sur sa silhouette telle de la sonnaille, qu’elle venait en ces lieux pour détruire ce secret qu’ils croyaient si bien gardé – à savoir que leur désir n’était que frousse. Et s’ils avaient eu l’ouïe fine, ils auraient entendu le claquement de son G-string en coulisse, sa manière à elle de leur dire adieu, le son d’une fronde venu parapher leur éviction hors du monde – ce monde que pendant onze minutes elle avait fait semblant de respecter, de magnifier. Elle crevait leurs nuits comme si ces dernières étaient des cerceaux de foutre, dont ils recueillaient, tard le soir, les débris scintillants dans leur mouchoir, tandis que leur épouse souriait en feignant de feuilleter un catalogue de mode. Ils se sentaient alors complices de cette jouissance nauséabonde qui rappelle au maître que, parfois, la trique est boomerang.
Sur un parcours authentiquement brûlant, où le politique et l’intime s’entrechoquent en un étonnant contraste de violence extrême et de douceur feutrée, Claro ne joue à aucun moment à l’essayiste, aussi tentants que soient ses puissants matériaux, mais, poursuivant une trajectoire d’écriture que l’on suit chez lui depuis un certain temps, et que l’on a vue s’accentuer entre « CosmoZ », « Tous les diamants du ciel » et « Dans la queue le venin » (dans un contexte plus frivole, pour ce dernier, en apparence), il atteint un sommet de grâce poétique, se permettant un usage rusé et éclairant de la typographie et de la mise en page, en de bien stratégiques moments, pour nous offrir, à la place d’un désespoir glaçant qui menacerait aisément, un très grand roman de quête personnelle et collective sous le signe de la beauté.
Il est temps de se poser cette question dont seuls, paraît-il, les dieux et les éphémères ont la réponse : est-il possible ::: de disparaître dans la nuit ? En une nuit ? De se trancher les ailes, et non les veines, avec le seul recours des dents, langue rentrée, loin des dernières volontés de la salive, et de faire taire pour ainsi dire le moteur du corps, de défaire ces grappes de noeuds qui n’étranglaient qu’eux-mêmes, d’écraser ce pouls maladroitement greffé au poignet comme si c’était une banale punaise de métal qu’on chercherait à enfoncer dans du noir capiton, les yeux définitivement clos sans que pèse sur eux ne serait-ce que la menue monnaie des regrets